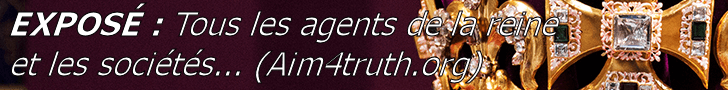C'est le plus brillant des intellectuels britanniques. L'auteur de la Pensée tiède, très bon connaisseur de la France, se penche pour Marianne sur les menaces qui pèsent sur notre pays et l'état de sa vie intellectuelle.

L'historien britannique Perry Anderson, né en 1938, fait partie des rares qui peuvent encore aujourd'hui se prévaloir du titre de penseur européen. Le regard qu'il porte sur la France, l'Allemagne ou l'Angleterre est d'une telle acuité qu'il fait honte à ceux qui sont dominés par des passions chauvines.
Observateur attentif de la vie intellectuelle française, il a publié en 2005 la Pensée tiède (Seuil), un essai sur l'affaissement de la pensée française depuis les années 80. Il vient de passer une année à Nantes afin de poursuivre sa réflexion sur les effets dévastateurs de la domination américaine dans le champ des études européennes et sur les dégâts causés par la pensée néolibérale.
C'est là que nous l'avons rencontré, à l'Institut d'études avancées (IEA), afin de dresser le bilan de la situation politique et intellectuelle en France. Fort de son regard éloigné et de sa connaissance approfondie de notre pays, il craint par-dessus tout que la France ne se normalise, en se laissant gagner par les idées néolibérales.
Perry Anderson : L'Institut d'études avancées de Nantes est une création unique, qui combine de vifs échanges intellectuels, un style original de sociabilité et une sensibilité aiguë aux rapports culturels Nord-Sud en une synthèse sans équivalent en Europe - ni, en fait, ailleurs.
Ici, vous êtes pendant un an avec des Africains francophones, des Indiens, des Chinois, des Brésiliens, des Russes et des Arabes, mais aussi des Français et des Allemands, ou d'autres chercheurs européens, en position d'en apprendre énormément chaque semaine sur le monde réel où nous vivons, qui n'est pas la bulle occidentale. La France peut être fière de cela.
La centralisation excessive de la vie intellectuelle - laissons de côté celle de l'administration - est souvent vue comme l'un des défauts de ce pays. Pourtant, la France est moins centralisée que la Grande-Bretagne, où le poids de Londres est bien plus important que celui de Paris, où les autonomies sont beaucoup plus faibles et où il n'y a pas de provinces dignes de ce nom.
Que l'institut donne sur la Loire plutôt que sur la Seine est un hommage à la diversité ancestrale de la France, ainsi qu'à son créateur, Alain Supiot. On ne pouvait imaginer moins provincial - au sens péjoratif du mot. Un observatoire idéal pour penser sur la France et sur le monde.
«Peu de dépêches sont aussi plates que celles en provenance de Paris», lanciez-vous dans votre essai la Pensée tiède, paru en 2004. Cette platitude - pour ne pas parler d'un sentiment d'abêtissement - se retrouvait, hélas, selon vous, dans la presse française, et en particulier dans le quotidien le Monde. Avez-vous changé d'avis à propos du «journal de référence» - j'ironise à dessein ? Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la presse et les médias français ?
P.A. : Il est vrai que la façon dont la presse britannique et américaine couvraient à l'époque votre pays était plutôt affligeante. La qualité de cette presse s'est encore détériorée. Ses récriminations se sont régulièrement faites plus stridentes et moins nuancées sur le fait que la France n'aurait prétendument pas encore pris la bonne dose du remède néolibéral dont elle aurait besoin pour devenir une société normale.
La presse française, elle, n'a pas tellement changé, me semble-t-il, mais, contrairement à ce qui se passe dans l'«anglosphère», elle s'est même légèrement améliorée. Le Monde, comme produit papier, reste plus ou moins ce qu'il était, avec, en plus, pléthore de suppléments « à l'américaine ».
La principale différence est que, si ce journal est depuis longtemps le bastion d'une forme d'atlantisme et de néolibéralisme qui a dû faire se retourner Beuve-Méry dans sa tombe, il a dû, sous les gouvernements de centre droit - ceux de Chirac et Sarkozy en particulier - calmer ses ardeurs libérales pour garder sa crédibilité, il est vrai faible, de journal d'opposition.
Maintenant que le centre gauche est, avec Hollande, au pouvoir, le Monde, qui soutient son chef, peut se libérer de tout scrupule et faire une campagne encore plus agressive et explicite en faveur d'un agenda néolibéral, afin de s'assurer que le gouvernement socialiste gagne en « sagesse économique » pour sauver la France, et se sauver lui-même.
Revenons également sur le tableau que vous dressiez du monde des idées, plus proches de la république du chacun pour soi dans les lettres que d'une véritable république des lettres ! Avez-vous constaté une progression vers une plus grande liberté d'esprit, une véritable indépendance critique, depuis dix ans ? Chez les historiens, les philosophes, les sociologues ?
P.A. : Quand j'écrivais sur la France en 2004, je distinguais deux plans : les médias et le monde intellectuel. Ce qui est propre à la France est certainement le niveau d'interconnexion entre les deux à Paris, depuis le début de la Ve République. Là où la liaison est trop forte, on a des déformations qui peuvent être grotesques : tel le cas Bernard-Henri Lévy. Mais les deux univers ne sont pas les mêmes et ils appellent des jugements de nature différente. Le conformisme de la presse est une chose. L'état de la vie intellectuelle en est une autre qui, tout en étant affecté par la première, ne doit pas être confondu avec elle.
On ne peut que noter, bien sûr, une baisse de la production depuis le milieu des années 70, même si elle n'est ni générale ni homogène. Beaucoup de grands esprits ont continué à produire des travaux très originaux, aux antipodes de tout conformisme intellectuel - parmi les penseurs dont j'avais parlé alors, il y avait Régis Debray, Pierre Bourdieu, Luc Boltanski, Alain Supiot ou Jacques Bouveresse. Depuis, dans le Nouveau Vieux Monde, publié en 2009 par Agone, j'ai ajouté Emmanuel Todd et Gérard Noiriel, et on pourrait encore probablement penser à d'autres.
Todd, notamment, a un tempérament iconoclaste. Il casse la baraque. C'est une vertu formidable. Son interview récente sur le hollandisme dans les pages de Marianne en est un exemple admirable. Son point faible est peut-être toutefois de trop vouloir conseiller les princes. Pour ce qui est de savoir si la situation est meilleure aujourd'hui qu'il y a dix ans, il est encore trop tôt pour le dire.
Ce qui est sûr, c'est que l'emprise de l'individualisme, du reniement des solutions collectives, la diabolisation de tout enthousiasme révolutionnaire, bref, de ce que l'on pourrait appeler, «la pensée 1978» [par analogie avec la Pensée 68, le livre de Luc Ferry et Alain Renaut], a diminué dans la sphère intellectuelle, alors qu'elle est devenue, dans la sphère politique, encore plus envahissante, comme le montre l'évolution du gouvernement actuel.
Quelle est alors, selon vous, la faiblesse majeure de la vie intellectuelle française ?
P.A. : C'est l'absence d'une vraie culture critique, au sens technique du terme. La France continue à produire plus de travaux théoriques originaux que tout autre pays européen, travaux qui frappent par l'audace de leur conception ou la profondeur de la réflexion. Mais ils ne suscitent guère de débat, que ce soit entre les penseurs eux-mêmes ou chez ceux qui pourraient les examiner.
Avez-vous des exemples ?
P.A. : Ils ne manquent pas. La principale revue d'histoire en France, les Annales, n'a jamais, autant que je sache, publié un seul point de vue critique sur les travaux de Michel Foucault, qui est souvent vu comme une sorte d'historien. Aucun chercheur en sciences religieuses n'a jamais, à ma connaissance, essayé de prendre la mesure critique des écrits de Régis Debray sur le monothéisme en général, et sur la chrétienté en particulier - d'ailleurs, on chercherait en vain une évaluation sérieuse de sa « médiologie ».
Un anthropologue s'est-il réellement attaqué au travail pluriforme d'Emmanuel Todd ? Y a-t-il en France des études sur le poststructuralisme d'un niveau comparable aux travaux du jeune philosophe anglais Peter Dews (Logics Of Disintegration), ou de Christopher Johnson, System And Writing In The Philosophy Of Jacques Derrida) ?
Prenez encore l'économie : la France est le seul pays occidental qui a produit nombre de diagnostics et de propositions de grande originalité pour faire face à la crise actuelle - Michel Aglietta, Jean-Luc Gréau, Jacques Sapir et autres -, alors que dans l'«anglosphère», on ne trouve que monétarisme et keynésianisme rances. Mais où débat-on sérieusement de ces travaux ? Dans l'«anglosphère», pas en France.
Ce verdict concerne-t-il également la réception des auteurs étrangers en France ?
P.A. : Hélas, oui. Critique, la revue fondée par Bataille afin de développer l'examen critique de travaux et d'idées, a récemment consacré un numéro spécial au grand historien italien Carlo Ginzburg. Peut-on honnêtement dire que les contributions publiées sont à la hauteur de cet idéal ? On manque cruellement en France d'une publication telle la London Review Of Books, le principal périodique européen en la matière.
Le résultat de ce vide est que la somme des productions de la culture contemporaine française - qui continue à être très active - est bien moindre que les parties souvent remarquables qui la composent.
L'expression «pensée unique», malgré ses faiblesses, donnait, selon vous, la mesure de la domination générale des idées favorables à une sorte de consensus européen, incapable de prendre acte des rigueurs de la mondialisation et de proposer une politique prenant en compte les aspirations des populations. Dix ans plus tard, qu'est-ce qui a changé en Europe principalement ? Qu'est-ce qui fait la différence sur ce point entre l'ère Sarkozy et le début de l'épisode socialiste ?
P.A. : La crise économique qui se développe depuis 2008 a radicalement intensifié la pression des élites européennes sur leurs sociétés, pour leur faire adopter l'ensemble des transformations néolibérales prônées depuis les années 90, mais encore loin d'être réalisées.
En France, les différences entre les gouvernements de Sarkozy et de Hollande sont les suivantes. Tous deux sont porteurs du projet néolibéral et tous deux ont eu besoin (comme généralement en Europe et aux Etats-Unis) d'un « supplément idéologique » afin de faire avaler à leurs électeurs les recettes arides de l'orthodoxie économique, et de leur faire oublier la détresse matérielle de leur condition.
Sous Sarkozy, le supplément, c'était l'« identité nationale » comme rempart contre les immigrants. Sous Hollande, c'est le « mariage pour tous ». L'un est à l'évidence plus léger que l'autre, mais sa fonction est la même : distraire les masses de l'augmentation du chômage, de l'abaissement du niveau de vie, de la dégradation des services publics, auxquels ces gouvernements ont présidé. L'autre différence entre les expériences Sarkozy et Hollande se profile seulement à l'horizon, mais elle sera la plus importante. Le centre gauche sera probablement un vecteur plus radical du programme néolibéral que le centre droit.
Premièrement, la crise est devenue plus aiguë, imposant des attaques plus drastiques de l'héritage de l'après-guerre, du genre que l'on voit déjà en Grèce, en Espagne, au Portugal et en Irlande - l'Italie étant la suivante sur la liste.
Deuxièmement, les gouvernements sociaux-démocrates sont typiquement mieux placés que les gouvernements conservateurs pour assurer une restructuration néolibérale de l'Etat-providence parce qu'ils peuvent non seulement compter sur une moindre opposition des syndicats, mais aussi brandir le spectre de la droite pour museler leurs partisans.
Ce n'est pas Merkel mais bien Schröder qui a fait passer le « programme 2010 » en Allemagne. Sans un soulèvement populaire majeur - le dernier datant de presque vingt ans [les manifestations de 1995], et la classe politique est devenue plus confiante -, on peut s'attendre à la même mise au pas en France.
La France, quant à elle, comme l'a rappelé le juriste Alain Supiot dans sa leçon inaugurale au Collège de France, fut pendant longtemps le terrain d'expérimentation de l'Etat social, des services publics notamment. Pensez-vous que cela soit toujours le cas ?
P.A. : L'introduction des 35 heures a été la dernière réforme sociale importante instaurée en Europe au XXe siècle. Cela a été fait en France, et nulle part ailleurs. Cette mesure a toujours été un sujet d'aversion pour l'opinion néolibérale, et maintenant, sans être formellement abrogée, elle est - comme vous le savez - régulièrement rognée. La leçon inaugurale d'Alain Supiot s'intitule Grandeur et misère de l'Etat social. Assurément, la grandeur est encore présente en France, mais, sans un soulèvement, c'est une misère croissante qui l'attend.
Propos recueillis par Ph.P.
Source : Marianne.net
Informations complémentaires :
Emmanuel Todd par BFMTV