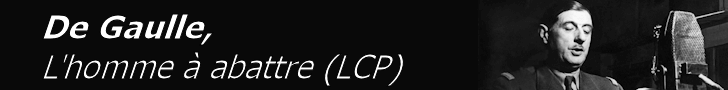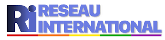Rappelez-vous ce que disait Marc Chesney (auteur aussi de la conférence hautement importante : « La crise permanente (Marc Chesney) », avec une taxe minime rien que sur les transactions par cartes bancaires. Il serait possible de non seulement payer ses impôts en temps réel, mais aussi de financer un revenu universel pour toutes et tous (vidéo ci-dessous). Aussi avec l'informatisation et la robotisation, il serait temps d'y penser, car à quoi cela serait-il utile de tant produire si les gens n'ont plus de travail et ne peuvent plus consommer... Quant à la probabilité d'une prochaine crise financière, l'inconnu n'est pas de savoir si elle aura lieu, mais quand....
Robert Boyer est un économiste hétérodoxe, chef de file de l’«école de la régulation» née dans l’euphorie des années 60, en réaction à l’enthousiasme du Prix Nobel d’économie Paul Samuelson, qui baptisait l’économie «science joyeuse de la croissance». Directeur de recherche au CNRS, Robert Boyer explique pourquoi les responsables politiques continuent de se faire les serviteurs de la finance au moment où il conviendrait de la mettre sous tutelle et alors que s’accumulent de nombreux signaux annonciateurs d’une prochaine crise d’ampleur mondiale (1).
A lire aussi Subprimes : une crise qui a fait dette
Depuis la libéralisation financière entamée au début des années 80, les crises financières se succèdent tous les cinq ans en moyenne. En craignez-vous une nouvelle ?
En effet, de la crise des dettes publiques des pays latino-américains dans les années 80 à la crise bancaire et de change des pays asiatiques dans les années 90, les autorités publiques ont eu tout loisir de mesurer les dangers d’une libéralisation financière. L’effondrement du système financier américain en 2008 a d’abord suscité l’effroi puis la volonté d’encadrer la finance à travers la loi Dodd-Frank, mais progressivement ont été oubliées les conséquences désastreuses pour les foyers américains dépossédés de leur logement. Au point que, pour le gouvernement Trump, il est temps de relâcher les contraintes imposées aux banques et institutions financières. Les cours boursiers de Wall Street s’envolent au-delà même des perspectives de croissance de l’économie américaine. Lorsque les médias financiers célèbrent la durée sans précédent de la phase de reprise économique, il est temps de s’interroger sur la possibilité d’un brutal retournement.
A la lumière de vos travaux portant sur la croissance fordiste de l’après-guerre, comment expliquez-vous ces crises à répétition ?
Dans le régime économique de l’après-guerre, aux Etats-Unis comme en Europe, le système financier était encadré par les autorités publiques car l’allocation du crédit était de leur responsabilité afin de favoriser la modernisation du système productif. Le taux d’intérêt dépendait des décisions de la Banque centrale. Par ailleurs, les flux internationaux de capitaux étaient essentiellement publics, de sorte que prévalait l’idéal de taux de change fixe. Disparurent alors les crises bancaires dans un contexte de fort investissement productif et de croissance rapide. Mais pour les tenants du libre marché, cette «répression financière» était intolérable.
Quand s’interrompt ce régime de croissance ?
Ce régime combinait dynamisme économique et stabilisation des inégalités à un niveau relativement bas, mais il bute sur une accélération de l’inflation et une montée du chômage. Le courant libéral va profiter de cet échec qui résulte de deux changements majeurs. D’une part, les grandes firmes, considérant la saturation du marché domestique, décident de recourir à l’exportation pour continuer à mobiliser les rendements typiques de la production de masse. Le salaire tend alors à devenir un coût et non plus une composante de la consommation et de la demande domestique. D’autre part, les grandes banques américaines décident de s’affranchir des réglementations domestiques pour créer à Londres un marché des eurodollars. C’est l’amorce du lent processus de création de marchés internationaux de capitaux qui s’affranchissent de toute réglementation nationale. Toutes les crises financières contemporaines sont les héritières de ce moment fondateur. Les autorités nationales ont fait sortir l’esprit de la finance de la lampe d’Aladin et aucun d’entre eux ne sait ni ne veut réintégrer la finance dans l’ordre politique domestique.
La finance exerce-t-elle toujours son pouvoir alors que certains affirment qu’elle a été mise sous tutelle par des gouvernements qui n’avaient pas lésiné sur les moyens pour éviter son effondrement ?
Avant la grande crise de 2008, l’opinion dominante était que les mathématiques financières permettaient une meilleure évaluation du risque et la création de nouveaux instruments financiers diffusant les risques aux acteurs les mieux équipés pour les porter. En fait, les produits dérivés toxiques liés au marché hypothécaire se concentrèrent en un petit nombre de grands groupes financiers que le Trésor américain dut sauver sans aucune contrepartie. Ce fut en contradiction avec une seconde croyance, à savoir qu’il serait aisé de combattre toute crise financière. Aujourd’hui encore, le marché du logement américain porte les traces de la grande crise de 2008 puisque des millions d’Américains n’ont pas retrouvé le chemin de l’accès à la propriété. La présidence Trump amorce une phase de dérégulation tout en poussant les feux de la spéculation. Le moment est mal choisi car la possibilité d’une crise est à l’ordre du jour. A nouveau, les politiques se font les serviteurs de la finance au moment où il conviendrait de la mettre sous tutelle.
D’où vient cette ascendance de la finance sur tant de sociétés contemporaines ?
Elle s’est appuyée sur l’affirmation que la libération des forces du marché est favorable à l’efficacité et la stabilité économique. Or la théorie est incapable de démontrer que tel est le cas pour les promesses de paiements qui sont l’objet des marchés financiers. La crise de 2008 aurait dû sonner le glas de cette croyance. Or ce n’est pas le cas car les financiers ont progressivement construit les bases d’un pouvoir qui s’impose aux gouvernements. En effet, la hiérarchie des pouvoirs est bouleversée quand le secteur financier est en position d’inventer et développer de nouveaux instruments sans contrôle des autorités et d’arbitrer librement entre actifs et marchés à travers le monde.
La finance prend le contrôle des entreprises cotées en Bourse car elle se présente comme le défenseur de l’intérêt des actionnaires. Alors que le capital productif suppose une coopération inscrite dans le moyen terme, les financiers sont opportunistes et obsédés par les arbitrages de court terme. Ils sont les premiers à réagir aux événements et leur choix s’impose à tous les autres acteurs. Les entreprises sont insérées dans les territoires et, par le travail, elles transforment la matière en des biens et services, alors que les entités financières opèrent dans l’abstraction et l’immatérialité de signes monétaires qui s’échangent dans le monde entier. Les premières ont à gérer l’irréversibilité de leurs choix passés, les secondes jouissent d’une extrême flexibilité dans leur stratégie puisqu’elles opèrent à l’échelle de la microseconde. Ainsi, le capital financier a pris le pouvoir tant sur le capital productif que sur des Etats surendettés qui ont recouru à la facilité de l’endettement, faute de mener les réformes nécessaires pour restaurer les finances publiques et les ressorts de la croissance. Ainsi s’est évanouie la volonté de reprendre le contrôle du destin économique national.
Selon vous, plusieurs capitalismes coexistent. Comment ces capitalismes sont-ils transformés par la finance ?
En effet, la financiarisation définie par la croissance des actifs et revenus financiers touche la quasi-totalité des pays. Pourtant, seuls les capitalismes américain et britannique se caractérisent par la domination du système financier sur la totalité des autres institutions et organisations : la concurrence, la relation salariale, la taxation et l’intégration internationale. Par contraste, c’est le dynamisme de l’industrie et de la réponse au marché mondial qui prime en Allemagne, pays dans lequel la finance n’est pas hégémonique. Le cas de la Chine est encore différent, puisque la puissance publique exerce son contrôle sur les aspects stratégiques de l’économie. La finance y est encore sous contrôle, mais elle peut finalement échapper, un jour, au Parti communiste chinois. Tout dépend donc de la relation hiérarchique entre financiers et responsables politiques.
Les gouvernements apprennent-ils des crises ?
Hélas assez rarement, comme en témoigne l’histoire des crises économiques en Argentine. Sous nos yeux se déroule une crise qui n’est autre que la répétition de celle ouverte en 2001 : un gouvernement a tenté de compenser un déficit commercial extérieur par l’entrée massive de capitaux à la recherche de rendements de court terme. Comme la compétitivité structurelle ne s’en trouve pas améliorée, brutalement les capitaux étrangers se retirent et déclenchent une triple crise de change, bancaire et des finances publiques. Rares sont les gouvernements qui apprennent des crises passées, domestiques comme internationales. Pour leur part, les agents privés tendent à oublier les circonstances et la gravité des crises financières passées, au point d’imaginer, après cinq à six ans, que l’économie connaît un nouveau cours, caractérisé par l’élimination des crises. C’est précisément à ce moment-là que la moindre nouvelle défavorable précipite un réajustement d’anticipations exagérément optimistes et que survient une crise. A ce titre, la situation américaine actuelle est préoccupante : les autorités publiques semblent avoir complètement oublié les raisons de la crise de 2008. De la même façon, l’essor continu des cours boursiers est interprété comme une anticipation des rendements réels futurs alors que c’est essentiellement la conséquence de la baisse de la fiscalité sur le capital et la poursuite d’une politique monétaire très favorable.
L’hégémonie de la finance peut-elle conduire à sa crise ?
Tout se passe comme si les grands acteurs de la finance comptaient encore sur un sauvetage par les autorités publiques en cas de nouvelle crise, en dépit des réformes qui explicitent que leurs actionnaires seront les premiers mis à contribution. Or, une crise équivalente à celle de 2008 se heurterait aux limites de l’action des pouvoirs publics, car l’opinion publique accepterait difficilement un sauvetage massif et sans condition. La revendication d’une nationalisation temporaire pourrait être entendue par des gouvernements soumis à la pression de mouvements défendant la souveraineté nationale.
Quel antidote à son pouvoir mondialisé ?
Il faut revenir à l’idée avancée par John Maynard Keynes et reprise par James Tobin : lorsque des marchés financiers ressemblent plus à des casinos qu’à des centres d’allocation rationnelle du capital, il est temps d’introduire des grains de sable dans les processus spéculatifs grâce à l’institution d’une taxe sur toutes les transactions. On entend souvent que ceci ne serait possible qu’à l’échelle internationale, solution qui serait bloquée par l’affrontement d’intérêts nationaux contradictoires. Ce raisonnement n’est pas exact car le Chili et la Suisse ont institué avec succès des mécanismes freinant l’entrée de capitaux spéculatifs afin d’assurer la stabilité macroéconomique. Ainsi sont évitées de coûteuses crises financières. D’un côté, nous avons une libre entrée des capitaux et l’acceptation des coûts des crises afférentes, de l’autre une restriction de leur accès au territoire national au prix d’une moindre croissance à court terme mais de l’élimination des crises bancaires et de change.
Ce pouvoir exorbitant des financiers finira-t-il par détruire la légitimité du capitalisme ?
Il n’est pas impossible que la prochaine crise financière déclenche une bifurcation majeure, à savoir la subordination de la logique financière à la recherche de la prospérité à l’échelle nationale. Dans un contexte où un nouveau système monétaire et financier international réaffirmerait la primauté des instruments collectifs, et non plus privés, dans la gestion des relations internationales.
(1) Economie politique des capitalismes, éd. La découverte, 2015.
Source : Libération.fr
Informations complémentaires :