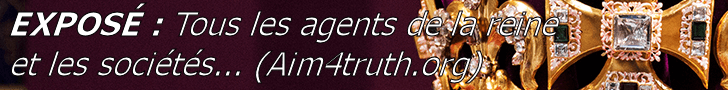On en parlait hier, aussi j’espère que Mediapart ne nous tiendra pas rigueur d’avoir partagé cet article, mais je pense qu’il est important de voir qu'il se passe des choses en dehors de nos frontières.
Bonne soirée,
F.

Bruxelles, de notre envoyé spécial. Un « désarroi idéologique ». La formule n'est pas tendre et, si l'on en croit un ouvrage très sérieux dont Mediapart a rendu compte en fin d'année dernière, elle résume à elle seule l'impasse dans laquelle se trouve la social-démocratie en Europe : en panne d'idées, mise à mal par la crise financière, contrainte à des coalitions avec la droite dans lesquelles elle perd souvent son âme.
Mais tout le monde ne partage pas ce constat accablant. Paul Magnette, très actif patron du PS belge et « bourgmestre » (maire) de la ville de Charleroi, continue de croire aux vertus d'une social-démocratie à réinventer. Dans un entretien à Mediapart, celui qui est aussi considéré comme l'un des meilleurs universitaires de la construction européenne, explique pourquoi ce courant politique est le mieux placé pour « réorienter » l'Europe : « Le capitalisme financier a été un échec. La désindustrialisation a été terrifiante, tout autant que le creusement des inégalités de revenus et de patrimoine. À nous de porter des propositions. »
Il a fallu quelques semaines à des pays en crise, comme la Grèce ou le Portugal, pour baisser les niveaux des retraites et du salaire minimum, à la demande de la Troïka. Mais il faudra plus de cinq ans pour mettre en place une taxe sur les transactions financières et mettre les banques à contribution. Comment faire pour ne pas détourner les citoyens de l'Europe ?
C'est difficile, c'est vrai. Mais vous choisissez des exemples qui vont dans ce sens-là. On pourrait en trouver d'autres. En Belgique, par exemple, le gouvernement n'a baissé aucun salaire, aucune pension, n'a pas touché à l'indexation automatique des salaires, pendant le gros de la crise. Par contre, on a augmenté de 15 à 25 % les prélèvements sur le capital. Et on l'a fait en quelques semaines.
Le problème, c'est que l'UE est une machine à décider extrêmement lente, qui n'a jamais su prendre de décision majeure que sous la pression d'une menace sérieuse. Il n'y aurait jamais eu les fondements de la CECA sans la crise annoncée du charbon et de l'acier, qui allait faire perdre des centaines de milliers d'emplois au secteur. Il n'y aurait pas eu le marché commun en 1951 si le risque d'une famine ne se profilait pas, obligeant à réfléchir à une politique agricole. Je saute des étapes : pas d'euro sans les attaques contre le franc et d'autres monnaies. Et il n'y aurait rien eu des horreurs du « 6-pack » et du « 2-pack » que l'on connaît aujourd'hui (des textes qui renforcent la discipline budgétaire en Europe, ndlr), si la crise financière de 2008 n'avait pas compliqué les trajectoires budgétaires nationales.
De Zapatero en Espagne à Gordon Brown en Grande-Bretagne, le bilan des gouvernements sociaux-démocrates face à la crise n'est pas glorieux. Ils ont, eux aussi, pratiqué des politiques d'austérité massives, sous la pression des marchés financiers. La social-démocratie a-t-elle encore aujourd'hui quelque chose à dire ?
Je crois beaucoup aux cycles dans l'Histoire, et un grand cycle social-démocrate commence, d'un point de vue intellectuel, dès les années 1930. L'économiste suédois Gunnar Myrdal théorise déjà, avant Keynes, les politiques redistributives. Cette pensée va être dominante des années 1940 à 70, y compris du côté des forces conservatrices, comme les gaullistes en France, ou les conservateurs britanniques pré-thatchériens. Tout le monde adhère à cette idée de gauche, d'une redistribution d'une partie des richesses, qui sert la croissance et permet de mettre en place des services collectifs.
Ce système s'enraie à la fin des années 1970, à cause de la « stagflation », cette période d'inflation et de stagnation économique, que la théorie keynésienne n'avait pas prévue. La gauche est prise de court intellectuellement. Et les crises intellectuelles sont les pires choses que la gauche puisse connaître. En face, les économistes Milton Friedman et Friedrich Hayek ont une réponse, le monétarisme. On baisse la taxation sur les capitaux, et c'est la masse monétaire libérée qui doit permettre de libérer l'activité économique. Avec une croyance qui durera longtemps : les inégalités de revenus, c'est bon pour la croissance. Aux Trente Glorieuses succèdent trente années néolibérales, avec l'apparition d'un capitalisme financier. Ce ne sont plus les ingénieurs, mais les financiers qui prennent les décisions à la tête des grands groupes.
Cette pensée-là finit par entrer en crise totale en 2008. De la même manière que le keynésianisme s'est trouvé piégé par le double choc pétrolier et par la stagflation en 1976-1977, la pensée monétariste est aujourd'hui entrée en pleine crise.
Mais en quoi la social-démocratie dispose, elle, de la réponse aujourd'hui ?
Le logiciel est en train de changer. Même dans les grandes institutions internationales. Le FMI dit aujourd'hui que ce sont les pays où les inégalités ont le moins progressé, qui affichent les meilleurs taux de croissance. On en revient à cela. Au fond, ce sont les pays qui se sont le plus opposés à Olli Rehn (l'ex-commissaire européen aux affaires économiques, aujourd'hui candidat aux européennes en Finlande, ndlr), en refusant de se plier aux cures d'austérité qu'il préconisait, qui s'en sortent le mieux. Et ceux qui se sont montrés les meilleurs élèves, comme les Pays-Bas, sont passés par la récession.
Le capitalisme financier a été un échec. La désindustrialisation a été terrifiante, tout comme le creusement des inégalités de revenus, comme de patrimoine. À nous de porter des propositions. Paul De Grauwe, l'un des économistes les plus respectés de Belgique, juge désormais qu'un impôt sur les grandes fortunes est devenu inévitable. Moi, je suis pour une « taxe Piketty » – même si l'intéressé n'aime pas que je l'appelle comme ça –, exactement comme on a parlé d'une « taxe Tobin ». Ce serait une taxe sur le capital, dont les recettes seraient réinvesties dans les services collectifs. C'est ça, ce que doit apporter la social-démocratie.
Mais le livre de Thomas Piketty auquel vous faites référence, Le Capital au XXIe siècle, a davantage suscité de débat aux États-Unis, qu'il n'a intéressé les socialistes français au pouvoir… Qu'en pensez-vous ?
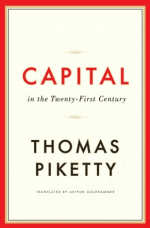 C’est vrai que les socialistes français ont pris un autre chemin ces derniers mois avec la politique de l’offre. En Belgique, nous avons fait le choix d’un autre chemin. Nous soutenons le pouvoir d’achat, parce que cela soutient notamment la demande intérieure et la croissance, et en parallèle, on soutient les entreprises qui innovent. C'est une évidence qu'il faut un « policy mix » équilibré…
C’est vrai que les socialistes français ont pris un autre chemin ces derniers mois avec la politique de l’offre. En Belgique, nous avons fait le choix d’un autre chemin. Nous soutenons le pouvoir d’achat, parce que cela soutient notamment la demande intérieure et la croissance, et en parallèle, on soutient les entreprises qui innovent. C'est une évidence qu'il faut un « policy mix » équilibré…
Pour revenir au débat français, il faut laisser à Manuel Valls le temps de montrer où il souhaite réellement aller. Et c’est d’autant plus difficile de faire un commentaire sur la politique française alors que mes camarades français sont comme nous en campagne électorale. Je ne veux pas que mes propos puissent être mal interprétés. Au-delà, on ne peut que constater que le FMI, l'OCDE, les grands économistes et les prix Nobel, disent tous aujourd’hui que c'est la redistribution qui est la clé de la croissance à venir.
« Une rupture se produit au moment de l'Acte unique »
La social-démocratie n'a-t-elle pas trop joué le jeu de l'Europe « néolibérale » pour être encore crédible aujourd'hui ? Pourquoi, par exemple, avoir voté le TSCG, ce traité qui renforce la discipline budgétaire en Europe ?
C'est compliqué à expliquer en peu de temps. Mais nous nous sommes battus contre d'autres textes, antérieurs, qui renforçaient déjà la discipline budgétaire (les règlements européens surnommés « 6-pack » et « 2-pack », ndlr). Mais à partir du moment où ces textes sont entrés en vigueur, il n'y avait en fait plus aucune contrainte budgétaire supplémentaire au sein du TSCG. Et par contre, si on ne votait pas le TSCG, on se privait d'une partie qui nous intéressait : le mécanisme européen de solidarité (MES), qu'on défend. À nos yeux, il n'y avait donc plus de raison de voter contre le TSCG.
Au-delà de ce traité, y a-t-il encore des marges de manœuvre pour une politique de gauche, depuis des institutions européennes marquées par l'« ordo-libéralisme » allemand ?
C'est vrai qu'il y a une forme d'idéologie monétariste très négative dans le discours européen aujourd'hui. La rupture se produit au moment de l'Acte unique (en 1986, ndlr). Jacques Delors le dit très bien dans ses mémoires. À l'époque, il faut obtenir un compromis avec Margaret Thatcher, pour qu'elle revienne au conseil européen. On prône que les décisions de dérégulation, au sein du conseil, seront prises à la majorité, tandis que les décisions de « re-régulation », en matière fiscale notamment, resteront, elles, à l'unanimité. Une asymétrie se crée.
Delors, pour lequel j'ai une grande admiration, a tout fait pour créer un dialogue social. C'était la fameuse « troisième mi-temps » sociale. Mais elle n'est jamais vraiment survenue. Sauf peut-être, à la marge, via le traité d'Amsterdam, à une époque où les sociaux-démocrates étaient plus en forme, dans les urnes, et ont poussé pour un agenda social. Mais depuis l'Acte unique, le problème vient de cette asymétrie : tout ce qui est lié à la rigueur budgétaire est contraignant, tout ce qui est lié à la convergence sociale est indicatif. Cela doit être corrigé.
Vous demandez d'en finir avec la règle de l'unanimité au sein du conseil, en matière de fiscalité, qui permet souvent à un État membre – au hasard, le Luxembourg – de bloquer certaines décisions qui le dérangeraient ?
On n'arrête pas de le dire. Mais il faut être lucides : cela ne s'annonce pas simple. Mais la lutte contre les paradis fiscaux a connu de vraies avancées ces derniers temps, preuve que l'on peut aussi contourner cette règle de l'unanimité. Cela avance, parce qu'à un moment, les États ont besoin de recettes. Et c'est le seul avantage stratégique de cette crise : les États finissent par accepter de faire des choses qu'ils n'auraient jamais accepté autrement. Je reviens à l'exemple belge : un tiers de l'assainissement budgétaire que l'on a pratiqué – 7,5 milliards d'euros sur un total de 22 milliards – vient de la lutte contre la fraude, et du durcissement de la fiscalité sur le capital.
Que pense le PS belge du projet d'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne (lire ici) ?
Nous avons fixé des balises extrêmement raides, tellement raides que ce sera pratiquement impossible à négocier. Et l'on ne ratifiera pas si ces balises ne sont pas respectées. Soyons clairs : nous ne sommes pas du tout favorable à ce traité et à sa philosophie. Je suis favorable à toutes les harmonisations et toutes les convergences, mais pas au prix d'un abaissement des règles qu'on a construites, au fil des décennies, via des combats politiques et syndicaux.
Scénario possible, à l'issue des élections européennes de fin mai : une alliance entre socialistes (S&D) et conservateurs (PPE) au sein du parlement européen pour désigner le futur président de la commission. Cela vous irait-il?
Je suis favorable à la majorité la plus progressiste qui soit ! Mais il faudra voir les chiffres à la sortie des élections…
Source(s) : Mediapart.fr via Chalouette
Informations complémentaires :